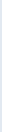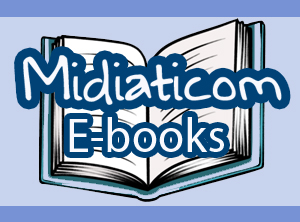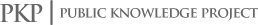Au-delà de la régulation, les médiatisations journalistiques entre marché de la discursivité et bien commun
Resumo
Dans cette contribution, il s’agit d’interroger le rôle et les divers positionnements des médias d’information politique et générale vis-à-vis des conflictualités politiques dans les processus de médiatisation des « faits d’actualité » et de construction des problèmes publics (auteur, 2012, 2015, 2019, 2023, 2024). Les médias seront examinés dans les tensions qui les traversent entre un idéal-type de l’intérêt général, constitutif du rôle qui leur est institutionnellement assigné (Cagé & Huet, 2021 ; Chupin et al.2012), et les contraintes et tactiques afférant à la mise en marché de leur discours (Veron, 1988).
Dans un contexte d’accroissement à la fois des rationalités productives des médias (Voirol, 2010 ; Miège, 1997) et de la mise en compétition des singularités socio-culturelles (Reckwitz, 2017), il s’agit de saisir la manière dont les médias d’information journalistique composent avec des formes de dislocation du social et de fragmentation de l’espace public (Miège, 1997). Plus précisément, nous questionnerons les possibilités laissées aux journalistes pour assurer non seulement une juste représentation des composantes de la société mais également une mise en dialogue des discours tenus par ces dernières. Le déploiement des singularités sur les réseaux socio-numériques, encouragé par le capitalisme culturel, fragilise en effet la cohésion sociale et rend plus que jamais nécessaire l’action de « médias médiateurs », facilitant la « résonance démocratique » (Rosa, 2022).
Le concept de pluralisme (Rebillard et Loicq, 2013 ; Mc Quail, 2013) y sera central, et je m’efforcerai d’en examiner les diverses manifestations empiriques puis d’en dépasser les limites pour identifier différentes configurations médiatiques répondant aux enjeux de l’espace public.
Médias et intérêt général : au fondement de l’institution journalistique
Historiquement, la presse a été pensée comme un outil d’éducation civique et de participation politique des citoyens (Chupin et al, op. cit.). La loi de 1881 sur la liberté de la presse a posé les bases de l’indépendance des médias, tout en encadrant leur responsabilité vis-à-vis du débat public. Elle est de ce fait « envisagée comme une suite logique du suffrage universel » (ibid., p.36). L’enjeu est de renforcer les libertés publiques pour ancrer un régime démocratique durable, tout en évitant que la presse ne devienne un outil de propagande ou de désinformation incontrôlé (d’où les exceptions à ce principe de liberté à l’article 24, telles que la diffamation, les injures, l’incitation à la haine ou l’atteinte à la sûreté de l'État). Découlant de la vision rousseauiste d’un contrat fondé sur une délégation d’autorité, ce statut d’institution de l’information journalistique au sein de la démocratie représentative garantit aux journalistes un certain nombre de droits et libertés, assortis d’engagements ou devoirs à l’égard des citoyen·nes, que viendra formaliser presque un siècle plus tard la célèbre Charte de Munich.
Aujourd’hui, l’idée d’un journalisme au service de l’intérêt général, voire d’une information comme « bien public » (Cagé & Huet, 2021), est centrale. Sur le plan théorique, mobiliser l’intérêt général permet de questionner le rôle des médias dans l’établissement et l’alimentation de rapports sociaux et politiques jugés désirables, ou préférables à d’autres car plus enclins à garantir l’épanouissement des individus, conformément au projet résolument émancipateur des Lumières. Cette référence à l’intérêt général se manifeste concrètement dans le champ journalistique par la définition de l’information politique et générale proposée par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP). Elle s’appuie d’abord sur une mention de l’intérêt général, lequel est brièvement défini à l’article D18 du code des postes et communications électroniques : les publications doivent ainsi « avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ». Le caractère « IPG » d’une publication repose ensuite sur l’article 2 du décret du 29 octobre 2009 et sur l’article 39bis A du code général des impôts. Le premier, destiné à circonscrire le statut de « Service de Presse En Ligne (SPEL) », dispose que « sont considérés comme d’information politique et générale les services de presse en ligne dont l’objet principal est d’apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l’actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d’éclairer le jugement des citoyens. » La reconnaissance IPG permet ainsi aux médias d’obtenir des aides publiques substantielles, quoique réparties de manière très inégalitaire et à leurs journalistes de jouir d’un certain nombre de prérogatives.
A ces définitions juridiques de l’IPG et de l’intérêt général, s’articule une appréhension de ce dernier par les journalistes, qui structure leurs idéaux-types professionnels, et certaines de leurs pratiques. Sur un plan plus général, l’attachement de certains journalistes au statut de bien commun de l’information aura motivé, ces quinze dernières années en France, un certain nombre d’initiatives d’ordre économique, technique ou socio-professionnel dont on peut considérer qu’elles relèvent d’une logique du commun, telle que définie par Christian Laval (2016), rompant radicalement avec la concurrence généralisée héritée d’une « rationalité capitaliste qui restructure l’ensemble des rapports sociaux » (ibid.).
Discours journalistiques et processus de médiatisation : le marché de la discursivité sociale
Cela étant, les médias prennent place, en France comme dans d’autres pays démocratiques, au sein d’une société libérale, marquée par un idéal d’autodétermination de la conduite de vie impliquant un certain nombre de choix et d’opérations sélectives. Le lien entre médias et publics ne peut donc, dans les faits, s’établir que dans un jeu de sélectivité croisée entre eux, tel que théorisé par les théories du contrat de communication (Charaudeau, 2005). Le libéralisme social porté par les Lumières constitue donc le terreau d’un marché de l’information médiatique, avec des médias supposément libres dans leurs choix éditoriaux, et des publics qui, toujours selon ces représentations idéaltypiques, ne le sont pas moins dans le choix des médias auxquels ils s’exposent. C’est ce que désigne la notion de marché de la discursivité sociale avancée par Veron (1988). Dans un mouvement analogue à celui de la démocratie représentative, ces choix électifs sont supposément conscients et éclairés, motivés par des affinités pratiques et éthiques, lesquelles sont encodées dans les éléments socio-symboliques des contrats de lecture des médias. Le marché de la discursivité sociale est donc un marché du dicible au sein de contrats de communication médiatique différenciés, obéissant aux lois de la concurrence et de la valoration distinctive.
Dans un contexte de fragmentation de l’espace public (Miège 1997), d’exacerbation des particularismes (Reckwitz, 2021) et d’extension du domaine médiatique (Lafon, 2017) accélérées par les réseaux socio-numériques, la question de la responsabilité des médias journalistiques se pose avec acuité : comment peuvent-ils articuler leur rôle d’institution démocratique avec les logiques de marché qui structurent leur environnement, quand de nombreux discours concurrents circulent également dans les « dispositifs de médiatisation » et « de communication » (Lafon, 2019) ? Dans la mesure où, au sein de ce marché de la discursivité, aucun média ne peut prétendre, seul, incarner ou relayer toute la diversité des expressions, la question du pluralisme apparait centrale.
Le pluralisme, une approche à interroger pour penser les liens entre médiatisation et démocratie
« Pluralisme politique », « pluralisme de l’information » ou encore « pluralisme des médias », autant de dénominations portées par des institutions politiques nationales ou transnationales (respectivement l’ARCOM, le Conseil d’Etat et l’UNESCO) attachées au maintien de la démocratie et conscientes de la nécessité d’un espace public intègre, permettant l’expression d’une diversité de courants de pensée et d’opinions. Cette conception du pluralisme a irrigué l’action des pouvoirs publics « en tant que législateurs, régulateurs et subventionneurs » des médias (Rebillard et Loicq, 2013, p.86). Il faut d’emblée rappeler qu’en France, le pluralisme est reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle, fondé sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et motivant un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel en matière de défense du pluralisme des médias (ibid., p.81). L’ARCOM et le Conseil d’Etat en assurent le volet de régulation, tandis que les aides publiques à la presse et aux médias en ligne, précédemment évoquées, sont en partie guidées par cet objectif.
Denis Mc Quail (2013) détaille les différents niveaux de mise en application du principe de media diversity : diversité du système médiatique, « se rapportant aux principales formes de propriété, aux propriétaires en tant que tels, au mode de régulation, à la structure financière, etc. » (p.26) ; diversité des sources, renvoyant « à la gamme des personnes, groupes, organisations ou autres qui ont accès aux supports de communication » (p.26) ; diversité des contenus, qui « renvoie au type d’information, d’opinions, d’idées ou de croyances qui peuvent être transmis » (p.27); diversité des supports, en référence « au type de medium (presse, radio, etc.) ainsi qu’à un titre ou une entreprise médiatique en particulier » (p.27) ; enfin la diversité des publics, qui tient à leur composition « en fonction de leurs divers attributs (p. ex. la classe sociale, l’âge, le style de vue, etc.) » (p.27).
Au fil d’une quinzaine d’années de recherche, j’ai ainsi placé l’étude du pluralisme de l’information sur trois plans distincts qui font écho à certains de ceux proposés par Mc Quail (op. cit.): le pluralisme des sujets abordés (relatif à une problématique d’agenda-building ), le pluralisme des cadres et cadrages (dans le sillage des media frames) et la diversité des sources mobilisées dans la couverture médiatique d’un sujet (en lien avec la sociologie des problèmes publics). La question est alors celle des possibilités qui sont données aux groupes divers constituant le macrocosme socio-politique pour porter à la connaissance de ce dernier leurs sujets d’intérêt et de préoccupation spécifiques, leurs conceptions et définitions de certains événements ou faits sociaux, ou encore leurs expériences et les significations ou enjeux qu’elle revêtent pour eux. Contre l’idée de délivrer une information frappée du sceau de la vérité, l’enjeu de la médiation journalistique serait donc de permettre à différents discours sociaux d’accéder au rang de discours médiatiques. La plupart du temps, ces facettes socio-symboliques du pluralisme sont interrogées au regard de sa composante socio-économique, que Mc Quail (op. cit.) désigne sous le vocable de « diversité du système médiatique ». L’enjeu est alors d’articuler dans une approche comparative, de la manière la plus systématique possible, dimension socio-économique d’encadrement de la pratique journalistique (type de médias, modèle d’affaires, support et périodicité notamment) et modalités ou matérialités des discours journalistiques produits.
La « représentation médiatique » et ses dynamiques socio-discursives, des sources aux publics
Ainsi, la media diversity (Mc Quail, 2013) et plus largement le pluralisme de l’information (Rebillard & Loicq, 2013) sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes, d’une contribution à l’intérêt général. En effet, on peut considérer à la suite de Rosa que l’opinion publique ne peut être confondue avec l’agrégation d’opinions et intérêts privés. Pour le sociologue, elle est plutôt « le résultat d’un processus dynamique de formation collective de la volonté démocratique » (p.81), qui fait écho au « rôle médiateur » des médias. Dans une référence appuyée à Habermas, Rosa évoque la nécessité, pour favoriser ce processus dynamique, d’espaces et de pratiques spécifiques de la publicité, et l’exigence d’un entrainement à cette dernière, adossé à des structures médiatiques qui l’encouragent, c’est-à-dire qui favorisent « un intérêt légitime pour ce type de formation de la volonté politique. » (p.82).
Cette conception peut être rapprochée du concept de « journalistic role performance » (Mellado et al., 2017) faisant désormais l’objet d’une étude comparative internationale. Fondée sur le modèle des systèmes médiatiques de Hallin et Mancini (2004, 2017), elle part du postulat que des rôles journalistiques idéaltypiques distincts dominent les normes et valeurs journalistiques dans les diverses zones géo-culturelles. Il est possible de s’inspirer de cette approche qui s’efforce de montrer comment ces normes et valeurs structurantes peuvent se matérialiser dans les textes , cristallisées par des indicateurs langagiers.
Des stratégies éditoriales délimitent et orientent la manière dont circulent les énoncés depuis les sources vers les publics, dans des modalités potentiellement très variées que je me propose de détailler. Au fil des analyses successives se sont dessinées et affinées des stratégies distinctives des médias, des positionnements que je me suis efforcé de repérer, en les plaçant sur des continuums formés par des paires de valeurs antagonistes (auteur, op. cit.) : productivité contre créativité, que l’on peut réduire au fait d’avoir une production importante sur le plan quantitatif ou de chercher au contraire des formes de renouvellement ; exhaustivité contre sélectivité, distinguant les médias s’efforçant de « parler de tout » de ceux faisant le choix de se concentrer sur certains sujets, et éventuellement de ne pas suivre l’agenda dominant ; réactivité contre réflexivité, qui renvoie à la fois à la question des délais de diffusion et à la notion déjà abordée de retraitement réflexif ; et enfin objectivation contre subjectivation, qui renvoie plus directement aux modalités énonciatives précédemment abordées. Les choix et arbitrages faits par les médias, qui se recoupent largement au fil des observations successives, cristallisent leur position au sein du champ journalistique. Rappelons que pour Veron (1988), sur le marché de la discursivité sociale, les stratégies de discours des médias s’inter-déterminent, chacun proposant à ses lecteurs-modèles (Eco, 1985) un mode d’appréhension du monde fondé sur des valeurs supposément partagées. Ces stratégies constituent en cela autant de réponses apportées par les différentes organisations aux tensions posées par leur double statut, dans un contexte économique et social de domination du néolibéralisme.
Elles sont de nature à établir un dialogue, à favoriser l’intercompréhension, ou au contraire à aiguiser les antagonismes et à renforcer les logiques d’affrontement. Au cours de la décennie écoulée, ces stratégies se sont considérablement enrichies et complexifiées sous l’effet des potentialités participatives du web, permettant aux publics internautes diverses formes de ré-énonciation des énoncés journalistiques, dans des configurations mêlant réception socialisée, conversation et interpellation. Mais indépendamment des raffinements successifs dont elle peut faire l’objet, la circulation sociale des discours par le biais du journalisme a pour objet de permettre la confrontation des individus avec des cadres d’interprétation du réel variés et contextualisés, condition sine qua non de l’établissement de liens politiques entre les membres d’une société.
Références bibliographiques
Cagé, J. et Huet, B. (2021). L'information est un bien public Refonder la propriété des médias. https://doi.org/10.3917/ls.cage.2021.01.
Charaudeau, P. (2005). Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours. Bruxelles : De Boeck – Ina.
Chupin, I., Hubé, N. et Kaciaf, N. (2009). Histoire politique et économique des médias en France. https://doi.org/10.3917/dec.chupi.2009.01.
Eco, U. (1985). Lector in fabula. Paris : Grasset.
Hallin, D., & Mancini, P. (2017). Ten years after comparing media systems: What have we learned? Political Communication, 34(2), 155–171.
Lafon, B. (2017). Médias sociaux : l’extension du domaine médiatique par l’industrialisation du relationnel. Les Enjeux de l’Information et de la Communication, 18(3A), p.53-64. https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2017/supplement-a/04-medias-sociaux-lextension-du-domaine-mediatique-par-lindustrialisation-du-relationnel/
Lafon, B. (dir.) (2019). Médias et médiatisation. Analyser les médias imprimés, audiovisuels, numériques, Communication en+, Presses universitaires de Grenoble, 310p.
Laval, C. (2016). « Commun » et « communauté » : un essai de clarification sociologique. SociologieS. Mis en ligne le 19 octobre 2016. http://journals.openedition.org/sociologies/5677 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.5677
McQuail, D. (2013). La diversité de l'information dans toute sa diversité : évolution d'un concept pour les médias et les politiques publiques. Dans Rebillard, F. et Loicq, M. (dir.), Pluralisme de l’information et media diversity Un état des lieux international. (p.19 -38 ). De Boeck Supérieur. https://doi.org/10.3917/dbu.loicq.2013.01.0019.
Mellado, C., Hellmueller, L., Márquez-Ramírez, M., Humanes, M. L., Sparks, C., Stepinska, A., & Wang, H. (2017). The hybridization of journalistic cultures: A comparative study of journalistic role performance. Journal of communication, 67(6), 944-967
Miège, B. (1997). La société conquise par la communication. Tome II : La communication entre l’industrie et l’espace public, Presses universitaires de Grenoble.
Rebillard, F., & Loicq, M. (2013). Pluralisme de l’information et media diversity. Un état des lieux international. De Boeck Supérieur
Reckwitz, A. (2021). La société des singularités. Une transformation structurelle de la modernité. Paris : Maison des Sciences de l'Homme.
Rosa, H. (2022). Résonance démocratique ou mondes vécus cloisonnés : Réflexions sur les transformations de l’espace public au XXIe siècle à partir de la théorie de la résonance. Réseaux, 235, 73-101. https://doi-org.sidnomade-2.grenet.fr/10.3917/res.235.0073
Veron, E. (1988) : Presse écrite et théorie des discours sociaux production, réception, régulation. In Charaudeau, P. (dir.). La presse : produit, production, réception. Paris : Didier-Erudition, p.11-26.
Voirol, O. (2010). La Théorie critique des médias de l'École de Francfort : une relecture. Mouvements, 61, 23-32. https://doi.org/10.3917/mouv.061.0023Corpo do texto.